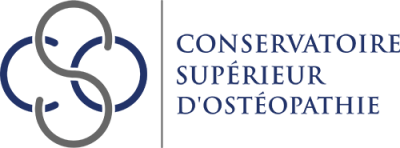Retour sur le colloque du 21 novembre à l’Hôpital Béclère : une journée d’échanges dédiée aux violences faites aux femmes
Des professeurs, enseignants-chercheurs et étudiants du Conservatoire Supérieur d’Ostéopathie (CSO) ont assisté à ce colloque organisé le vendredi 21 novembre à l’Hôpital Antoine-Béclère (AP-HP). Leur participation s’inscrit pleinement dans la volonté du CSO d’élargir les perspectives et d’intégrer des approches issues de disciplines complémentaires, tout comme le GreMIC.
En cette semaine internationale de lutte contre les violences, comment prendre en charge ce fléau et aider les personnes qui en sont victimes ?
Au CSO, la formation des futurs ostéopathes repose également sur la compréhension du contexte social, psychologique, médical et institutionnel dans lequel s’inscrivent les patients. L’ostéopathie propose une approche globale des traumatismes pour les patients ayant subi des violences, prenant en compte à la fois les symptômes physiques et les répercussions psychologiques.
Assister à ce type d’événements permet de croiser les expertises, de nourrir la réflexion pédagogique et de renforcer la capacité des étudiants à appréhender les situations complexes qu’ils rencontreront dans leur pratique professionnelle.
Cette journée de colloque a réuni acteurs institutionnels, professionnels de santé, associations et partenaires engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a été ouverte par Clément Corriol, Directeur de l’Hôpital Antoine-Béclère, et Marine Muscat Orbach, sage-femme chargée de la coordination du parcours au sein de la Maison des Femmes de l’établissement, rappelant l’importance de ces espaces d’échanges pour renforcer les dispositifs d’accompagnement.
Une prise en charge médicale du patient à adapter selon son expérience traumatique
La violence peut entraîner des conséquences importantes et durables sur la santé. Christina Nicolaidis et al. (2004) ont constaté que de multiples formes de violence sont associées à une augmentation des symptômes physiques chroniques et des problèmes de santé mentale. Les ostéopathes reconnaissent ces effets complexes. Roel te Kolstee et al. (2004) ont démontré comment adapter le traitement aux expériences traumatiques des patients, notamment en modifiant les techniques de manipulation afin d’éviter de les réactiver.
Torsten Liem et al. (2020) soulignent plus particulièrement l’importance de traiter les manifestations physiologiques du traumatisme, notant que les expériences traumatiques peuvent engendrer des réponses de stress autonomes persistantes. Cette approche met l’accent sur la promotion de la relaxation physique et mentale, tout en impliquant activement le patient dans son processus de guérison.
K.M. Cuevas et al. (2017) soulignent le besoin crucial pour les prestataires de soins de santé de comprendre les impacts neurobiologiques des expériences traumatiques, en particulier les agressions sexuelles, qui touchent 1 femme sur 3 et 1 homme sur 6.
Femmes en exil : comprendre les parcours et les vulnérabilités
La première conférence était consacrée aux femmes en exil et à la complexité de leurs trajectoires.
Animée par Yann LeGall, psychologue clinicien à l’Équipe Mobile Psychiatrie Précarité Sud 92, et Dr Ouardia Otmani, psychiatre et cheffe de pôle à l’Hôpital Paul Guiraud, cette intervention a mis en lumière les vulnérabilités spécifiques de ces femmes confrontées à des ruptures multiples : géographiques, familiales, sociales et psychiques.
Les intervenants ont souligné l’importance d’une approche mobile, coordonnée et adaptée aux réalités de ces publics fragilisés.
Mise à l’abri des femmes victimes de traite : repérer, orienter, protéger
L’Association AFJ a présenté un dispositif de mise à l’abri pour les femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle.
L’intervention a permis de rappeler les indicateurs essentiels pour repérer ces situations souvent invisibles, ainsi que les mécanismes d’orientation vers les structures spécialisées.
Nous avons également pu en savoir plus sur le parcours de ces individues exposées de manière continue à la violence, de l’enfance à leur sortie du réseau et à leur prise en charge.
Femmes en situation de handicap : une réalité trop souvent silencieuse
Trois intervenantes expertes ont apporté un éclairage complémentaire autour d’une table ronde consacrée aux violences vécues par les femmes en situation de handicap :
Céline Poulet, secrétaire générale du Comité Interministériel du Handicap, Marie Rabatel, experte violence et handicap, membre de la CIIVISE et présidente de l’Association Francophone des Femmes Autistes, Chantal Rialin, présidente de l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA).
Cet échange a révélé la multiplicité des violences subies, leur banalisation, ainsi que les obstacles persistants à l’accès à l’aide, à la justice et à l’autonomie.
Comprendre et accompagner les auteurs de violences : le passage à l’acte à l’adolescence
Bérénice Porot, psychologue à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Ministère de la Justice), a présenté une analyse fine des dynamiques qui peuvent conduire certains adolescents à commettre des actes violents.
Elle a souligné l’importance de l’accompagnement éducatif, psychologique et familial pour prévenir les récidives et favoriser la reconstruction.
Le numéro vert pour les auteurs : un outil essentiel de prévention
Mateusz Evesque Pironneau, Délégué général de la FNACAV, a rappelé l’importance de cet outil préventif, qui permet d’engager un travail en amont, avant le passage à l’acte ou la récidive, en orientant les appelants vers des structures d’accompagnement.
Violences intrafamiliales et évaluation psychocriminologique
La dernière intervention a été assurée par Alain Javay, psychomotricien psychothérapeute au Centre Médico-Psychologique de la Garenne-Colombes, antenne de psychiatrie et psychologie légale du Dr Coutanceau.
Son exposé a porté sur l’évaluation psychocriminologique des auteurs de violences au sein du couple. Il a présenté les outils d’analyse, les profils types, ainsi que les perspectives thérapeutiques permettant de réduire le risque de récidive.
La journée s’est conclue par une allocution du Professeur Alexandra Benachi, Cheffe du service de gynécologie-obstétrique de l’Hôpital Béclère, qui a salué la qualité des échanges et réaffirmé l’importance de ces rencontres pour améliorer la prise en charge des victimes et renforcer la compréhension des mécanismes de violence.
Une journée utile et engagée
Ce colloque a offert un espace de réflexion essentiel, mêlant expertise, retours de terrain, analyses institutionnelles et témoignages de professionnels engagés.
Il souligne la nécessité d’une action collective, coordonnée et continue pour lutter contre les violences faites aux femmes et développer des réponses adaptées à chaque situation.
Sources :
- Nicolaidis, C., Curry M., MacFarland, B. et al. Violence, mental health, and physical symptoms in an academic internal medicine practice. J GEN INTERN MED 19, 819-827 (2004)
- Kolstee R, Millet JM, Knaap SF. Routine screening for abuse : opening Pandora’s box ? J Manipulative Physiol Ther. 2004 Jan;27(1):63-5
- Torten Liem, Winfried Nenhuber, Psychosomatische Osteopathie bei Trauma am Beispiel der bifokalen Integration, Osteopathische Medizin, Volume 21, Issue 4, 2020,6-13
- Cuevas, Kristen M., Balbo, Jane, Duval, Krista and Beverly, Elizabeth A.. “Neurobiology of Sexual Assault and Osteopathic Considerations for Trauma-Informed Care and Pratice” Journal of Osteopathic Medicine, vol. 118, no. 2, 2018, pp. e2-e10